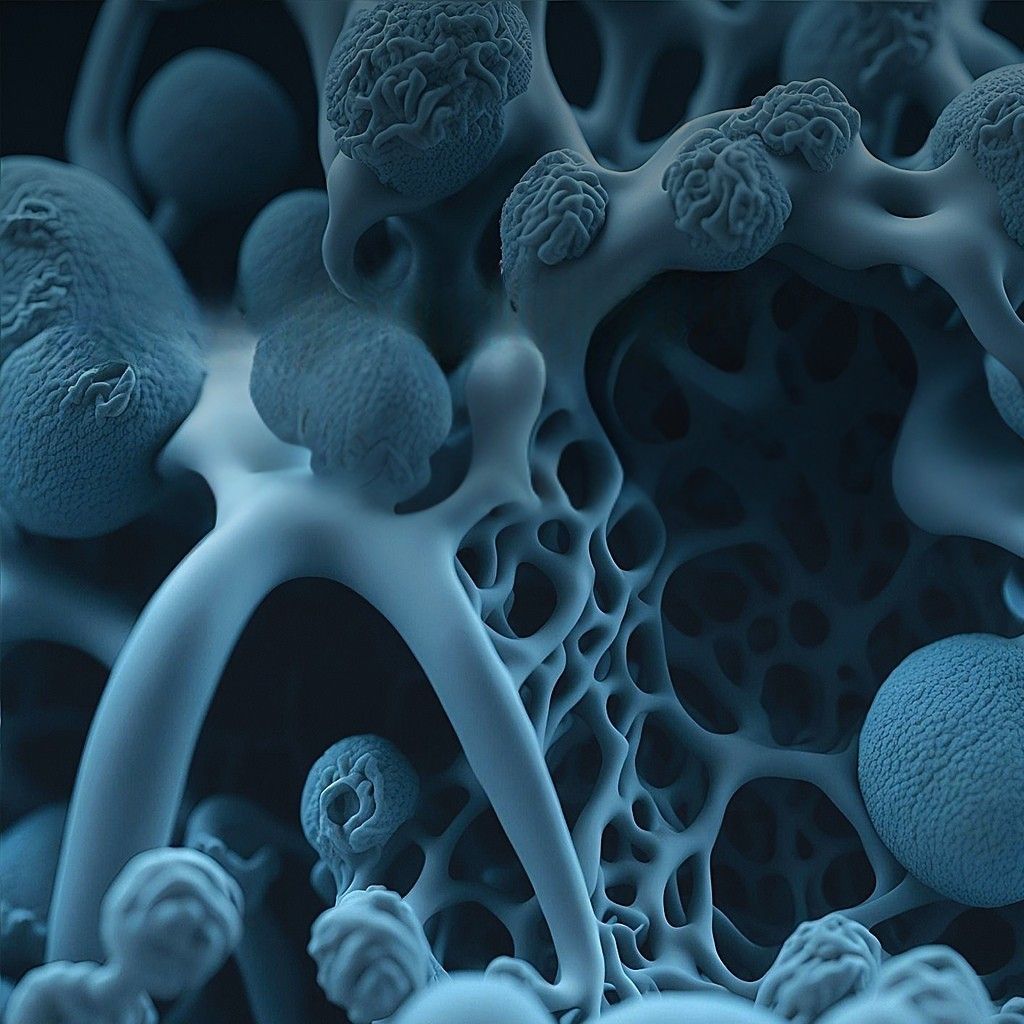par Claude Gautier, t.p. conseillère Agrocentre Lanaudière inc.
•
17 mars 2025
Il existe une multitude de fongicides commerciaux sur le marché. Ceux-ci diffèrent par leur matière active, et sont classés en différents groupes, selon leur mode d’action sur le pathogène. Les ingrédients actifs qui les composent rendent chaque fongicide unique quant à sa persistance et son efficacité contre différentes maladies. Dans cet article, nous allons discuter des bonnes pratiques à adopter pour ralentir le développement de résistance des pathogènes aux fongicides, vous présenter des exemples concrets et proposer des produits alternatifs aux pesticides de synthèse. Au fil des années, nous avons observé une régression concernant l’efficacité de certains fongicides. La résistance aux fongicides est la réduction, acquise et héréditaire, de la sensibilité d’un pathogène à certains fongicides. Il existe des résistances disruptives, qui se produisent très rapidement et sont faciles à observer parce qu’elles causent une perte brutale de sensibilité au fongicide, même si on augmente la dose. Il y a aussi les résistances durables, qui impliquent une décroissance lente de l’efficacité du fongicide, qui peut offrir un contrôle acceptable du pathogène sur plusieurs années avant de devenir inefficace. La brûlure stemphylienne de l’oignon est un très bon exemple d’une maladie émergente où la résistance s’est développée rapidement. La maladie a été découverte il y a un peu plus de 15 ans en Ontario, et est déjà résistante aux fongicides du groupe 11, et ceux du groupe 7 perdent graduellement en efficacité*. Afin de ralentir le développement de la résistance, il est conseillé d’utiliser des produits du groupe M en prévention et d’utiliser à bon escient ceux du groupe 7, qui s’avère le plus efficace sur la maladie. D’autres cas similaires sont observés dans les fruits avec la moisissure grise et dans la pomme de terre avec la brûlure hâtive. L’apparition de résistances est souvent liée à la surutilisation d’un produit qui était à l’origine excellent sur les champignons sensibles : il existe donc plusieurs moyens de ralentir ce phénomène. Tout d’abord, il faut savoir que les mauvaises performances d’un fongicide ne sont pas toujours attribuables à la résistance. Il s’agît le plus souvent d’un problème en lien avec le moment d’application ou l’environnement. Je m’explique : la majorité des fongicides sont préventifs, c’est-à-dire qu’ils empêchent la germination des spores, donc l’apparition de la maladie. L’effet curatif recherché par un fongicide appliqué tardivement n’est pas visible à l’œil nu ; la croissance mycélienne à l’intérieur de la plante est stoppée, mais les tissus endommagés ne peuvent pas être réparés. Les meilleurs résultats sont observés avec des traitements qui ont été faits au tout début de la maladie. Plusieurs outils nous permettent d’arriver à cibler le bon moment d’application. Le dépistage hebdomadaire complet permet de détecter le début d’un foyer d’infection, c’est le mandat du dépisteur de parcourir le champ au complet pour surveiller son apparition. Les foyers d’infection forment généralement un rond et l’utilisation d’un drone ou des images satellites peut parfois permettre de les détecter. Un autre outil serait de faire un horaire prédéterminé de traitements, basé sur l’historique des années précédentes, et d’ajuster ensuite en cours de saison selon la météo, le dépistage et les différentes sources d’informations disponibles, comme le réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP), les modèles prévisionnels et les capteurs de spores. Pour retarder l’apparition de résistances, alterner les groupes de fongicides est primordial ; on ne devrait jamais utiliser des produits du même groupe pour deux applications consécutives. Utiliser un fongicide qui contient 2 matières actives aide aussi à prolonger l’efficacité des fongicides, mais il faut que les 2 molécules du mélange ciblent la même maladie, en agissant différemment contre celle-ci. L’ajout d’un engrais foliaire contenant des biostimulants, l’ajustement du ph de la bouillie, l’utilisation d’un volume d’eau adéquat et une météo favorable peuvent améliorer significativement la performance des traitements. Voici un inventaire des produits ayant plusieurs modes d’action à intégrer dans vos régies : les fongicides du groupe M (multisites), et du groupe BM (biologiques multisites). La rotation des traitements avec des produits comme le OxiDate® 2.0, le Confine®, le Captan et autres, qui ont pour effet de sécher les spores pour limiter la propagation des maladies, peut réduire de beaucoup les sites d’infection dans un champ. Les cuivres offrent un large spectre de contrôle des maladies fongiques et bactériennes pour lesquelles les solutions de traitement sont très restreintes. Les cuivres procurent une forte protection de contact et une action résiduelle limitée. De ce fait, la couverture de tout le feuillage est très importante, le pH de la bouillie doit aussi être vérifié. Selon Engage Agro, le Cueva® est l’un des seuls fongicides à base de cuivre à pénétrer légèrement la cuticule de la feuille, ce qui lui donne une capacité résiduelle plus longue. La compagnie UAP offre trois types de cuivres, et fournit des détails sur chacun, nous permettant de choisir le produit qui est le mieux adapté à la situation rencontrée. Le cuivre est phytotoxique si mélangé en réservoir avec un produit translaminaire ou un engrais foliaire. Il a un délai de récolte d’un jour dans la majorité des cas. Le mélange du cuivre avec un autre fongicide du groupe M conditionne les bactéries à mieux absorber les ions de cuivre qui peuvent ainsi les dénaturer plus efficacement. Le groupe M inclut aussi les fongicides protecteurs comme le Captan, le Bravo®, le Manzate®, etc … L’efficacité de ces produits dépend beaucoup des adjuvants inclus dans le mélange. Syngenta propose la technologie Aqua Résistant® avec le Bravo® qui permet une adhérence sur le feuillage malgré 5 pouces de pluie. Les fongicides protecteurs ne pénètrent pas dans la plante et n’ont pas d’effet curatif. Ces produits sont fréquemment réévalués par l’ARLA à cause de leur profil environnemental ; les délais avant récolte sont de plus en plus longs pour ces produits. Les agents biologiques composant le groupe BM possèdent plusieurs mode d’action. Ils constituent une solution de rechange en culture biologique mais sont aussi très utiles pour la gestion de la résistance. En voici quelques exemples : Minuet® (Bacillus subtilis), et plusieurs autres produits à base de Bacillus, RootShield (Trichoderma harzianum), etc. Finalement, certains produits, qui ne sont pas considérés comme des fongicides, peuvent tout de même aider, de manière préventive, en stimulant les mécanismes de défense naturels de la culture. Ils n’agissent pas directement sur les pathogènes, mais aident la plante à y faire face. LALRISE® START (Bacillus velezensis) est un bon exemple de ce type de produits ; selon Lallemand Plant Care, il forme un biofilm à la surface des racines, qui aide à l’absorption du phosphore et contribue à la santé du plant. Certains mycorhize, comme le nouveau AGTIV® IGNITE™ (Serendipita indica), peuvent atténuer les stress abiotiques, augmenter le taux de photosynthèse, améliorer l’établissement, la croissance et le rendement des plantes. Ce sont des options à considérer dans l’optique d’une lutte intégrée aux maladies fongiques. * https://onionworld.net/2022/11/29/battle-against-blight-stemphylium-leaf-blight-in-ontario/